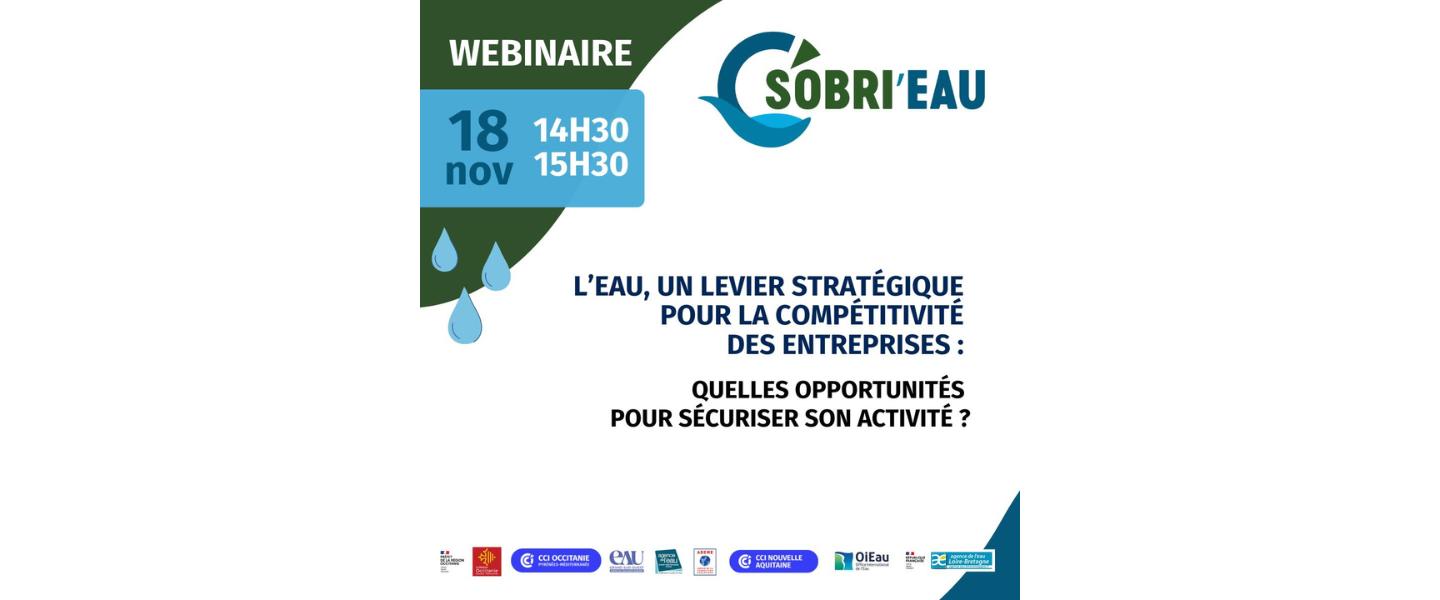“Dans le vaste champ de l’adaptation au changement climatique, l’eau occupe une place centrale...”
Publié le
Vivian Dépoues est responsable de la thématique Adaptation au changement climatique à l’Institut de l’Économie pour le Climat (I4CE).
Fondé par la Caisse des Dépôts et l’AFD, l’Institut a pour mission d’éclairer le débat sur les politiques publiques d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Aux côtés de Guillaume Dolques et François Thomazeau, Vivian Dépoues vient de publier une étude intitulée « Adapter la France à +4°C : moyens, besoins, financements ».

Quelles sont les principales conclusions de votre étude ?
Notre étude montre que, si l’on considère les moyens nationaux explicitement dédiés à l’adaptation au changement climatique, ceux-ci représentent 1,7 milliards d’euros par an. Et, sur cette somme, plus de la moitié des moyens sont issus des Agences et de la politique de l’eau.
C’est un premier enseignement intéressant pour le monde de l’eau de constater que dans le vaste champ de l’adaptation au changement climatique, l’eau occupe une place centrale.
Un deuxième point important est que si on se limite uniquement aux moyens labellisés « adaptation au changement climatique », on passe à côté d’une grande partie du sujet. On ne voit que la partie émergée de l’iceberg. De nombreux programmes, politiques publiques ou investissements contribuent eux aussi à l’adaptation et nous aident à mieux nous préparer aux impacts du changement climatique. On parle alors, de plusieurs dizaines de milliards d’euros…
Par exemple, d’autres politiques vont concerner le domaine de l’eau comme les politiques agricoles, d’aménagement du territoire ou encore de développement touristique.
C’est cette vision d’ensemble qu’il faut adopter pour comprendre tous les leviers de l’adaptation.
Quels autres enseignements pouvez-vous nous partager ?
Nous avons aussi regardé ce que ces moyens disent de notre manière de nous adapter. On constate que nous sommes dans des formes d'adaptation qui sont plutôt réactives. On engage des moyens quand on est confronté à une crise. L’anticipation reste difficile.
On commence à essayer de se projeter à avoir des visions prospectives mais on a encore fait assez peu de véritables arbitrages de politiques publiques. Peu de décisions ont été prises pour allouer des moyens, opérer des choix ou investir de manière anticipée. Les 12ᵉ programmes d’intervention des agences de l’eau constituent à ce titre un exemple fondé sur une approche prospective.
Autre point important, une grande partie des moyens dédiés sert aujourd’hui à faire tenir, le plus longtemps possible, les modèles en place. On est sur une logique de : “tout changer pour que rien ne change”. En d’autres termes, on investit beaucoup pour faire perdurer ce qui existe déjà, ce qui peut tout à fait s’entendre dans certains cas. Il s’agit souvent de préserver des filières économiques importantes pour des territoires, ou encore de maintenir des niveaux de services publics.
La question est jusqu’où cela tient dans un monde avec changement climatique ? À partir de quel moment vouloir à tout prix maintenir devient trop coûteux ?
Ce sont des débats que l’on connait peut-être un peu mieux dans le monde de l’eau. On va par exemple sur certaines filières agricoles se poser la question du maintien de l’irrigation. Il n’y a pas de réponse simple à ces questions.
Ce que l’on observe, c’est que bien souvent, les choix faits sont très implicites : on décide de maintenir certains modèles sans vraiment expliciter ce que cela va coûter à terme.
Et c’est justement sur ce point que nous cherchons à attirer l’attention : il est nécessaire de rendre explicites les conditions de ce maintien. C’est un préalable pour pouvoir faire collectivement le choix de la conservation ou de l’accompagnement de transformations plus profondes.
Et puis, pour finir, le dernier message est qu’il existe en réalité beaucoup d’options possibles pour aller plus loin.
On peut voir ça comme un jeu de briques : on assemble différentes solutions pour construire des stratégies, souvent locales, adaptées aux territoires.
Certaines options visent à maintenir les modèles existants. Dans ce cas, on est face plutôt à des investissements lourds : infrastructures, équipements de protection, transferts d’eau, mobilisation de ressources non conventionnelles...
D’autres options visent à transformer, à repenser l’aménagement, à faire émerger de nouvelles filières économiques moins dépendantes de l’eau. Et là, les investissements sont d’abord d’une autre nature : accompagnement, formation, coordination…
Bref, on parle de leviers de natures très différentes, et la question, c’est bien de savoir où l’on choisit de mettre les moyens.
Je vous cite « moins nous anticiperons, plus cela coûtera cher aux finances publiques ». Comment faire pour éviter cette situation ?
Effectivement, quand on n’anticipe pas, ce qui reste encore souvent le cas face au changement climatique, on finit par subir ses effets. Et là, on se retrouve face au mur, en situation de crise.
Le réflexe, c’est alors de se tourner vers la puissance publique. On l’a bien vu en 2022 : gel tardif, sécheresse, crises agricoles… Les revenus des agriculteurs sont impactés, et pour des questions de survie, ils se tournent vers l’État qui débloque des aides d’urgence. Même chose après des catastrophes naturelles : on mobilise des fonds publics pour réparer, reconstruire, indemniser.
C’est légitime dans ces moments-là, parce qu’il faut protéger les populations et relancer l’économie. Mais le constat, c’est que dans ces cas, le financement public s’impose comme la seule option. Alors que certaines solutions d’anticipation peuvent trouver leur modèle économique autrement parce qu’elles ont des co-bénéfices, elles peuvent intéresser d’autres acteurs et souvent coûter moins cher.
Même quand elles ne réduisent pas forcément la dépense globale, elles permettent de mieux répartir les coûts et d’éviter de devoir débloquer, dans l’urgence, des aides publiques massives.
C’est pour cela que j’insiste sur ce point : ne pas anticiper, cela finit toujours par peser beaucoup plus lourd sur les finances publiques.
Selon vous, quel modèle de financement est à la fois socialement acceptable, soutenable à long terme et politiquement réaliste ?
La question du modèle de financement, c’est la dernière partie de notre étude et c’est sans doute celle où, pour l’instant, on soulève plus de questions qu’on n’apporte de réponses.
On constate qu’il existe déjà beaucoup de débats sectoriels sur le sujet : dans le domaine de l’eau par exemple, autour de la réforme des redevances ou de la tarification de l’eau.
En réalité, sous-jacente à ces discussions se pose la question de comment répartir l’effort d’adaptation : en fonction des propensions à payer ? en fonction des bénéfices ? de la légitimité d’accès à la solidarité nationale ?
Dans notre travail, on a donc surtout cherché à consolider les propositions sur la table, l’état des débats, les pistes testées dans différents secteurs.
Nous n’avons pas la prétention d’avoir le bon mix.
Ce qui ressort, c’est qu’il existe des bénéficiaires bien identifiés des actions d’adaptation, il existe des bénéfices qui peuvent être intégrés dans des modèles économiques par des questions de valeurs assurantiels des dommages évités ou des co-bénéfices…
Une partie de ces financements pourrait être portée par des acteurs privés, ou par des logiques de tarifs d’usages, ou encore d’autres modèles à inventer…
Mais on reste face à un équilibre délicat, très politique : entre équité, compétitivité et responsabilité collective. C’est un chantier ouvert, et c’est clairement l’un des grands défis des années à venir.